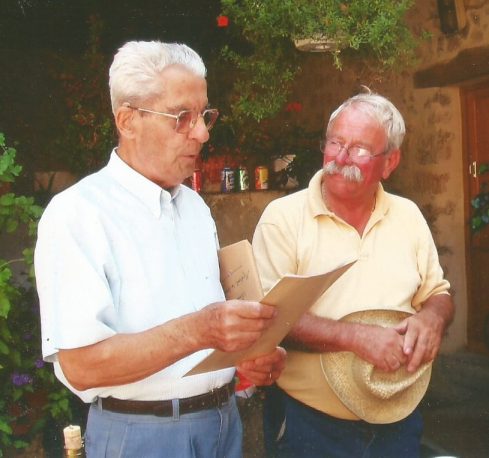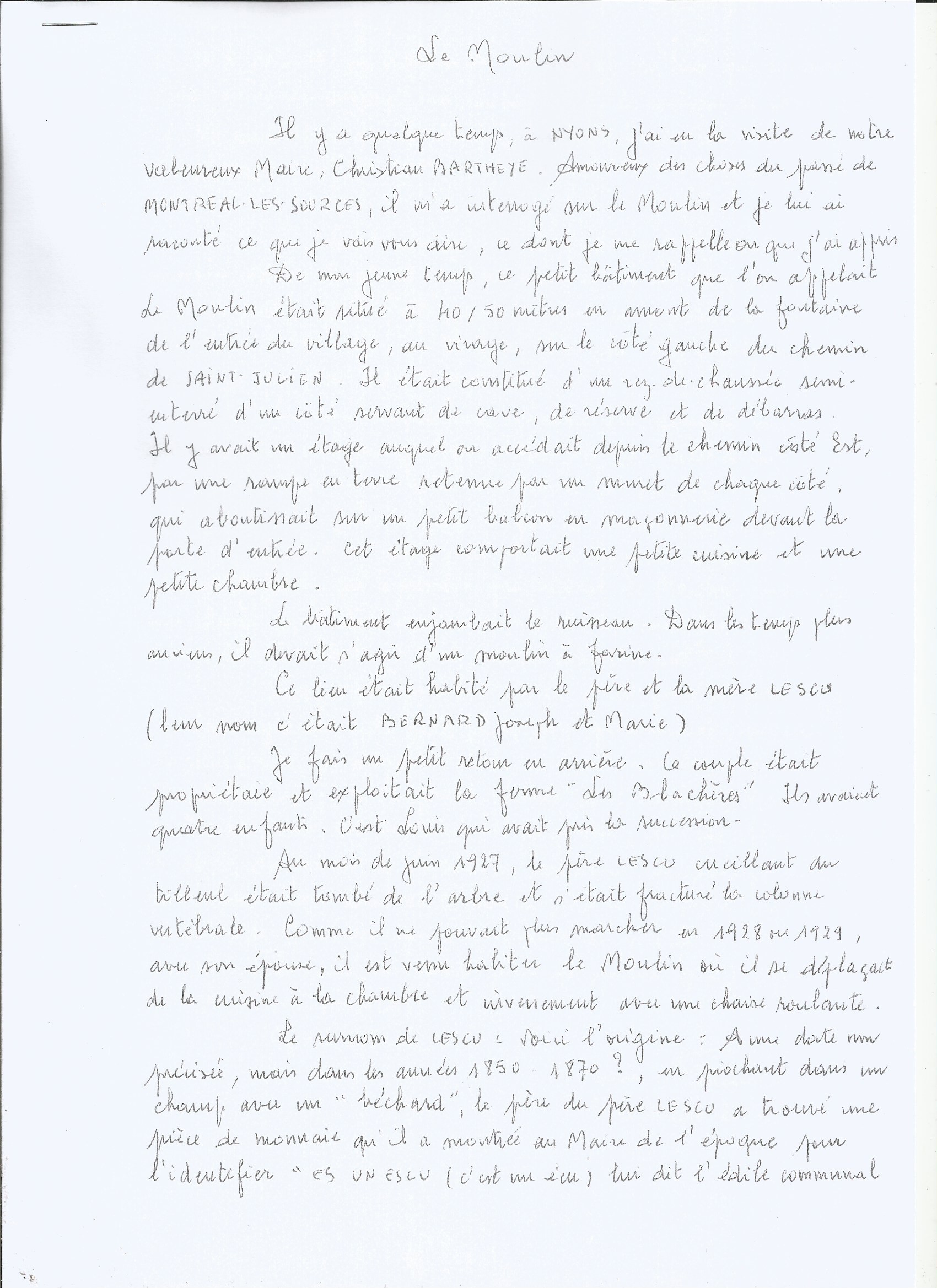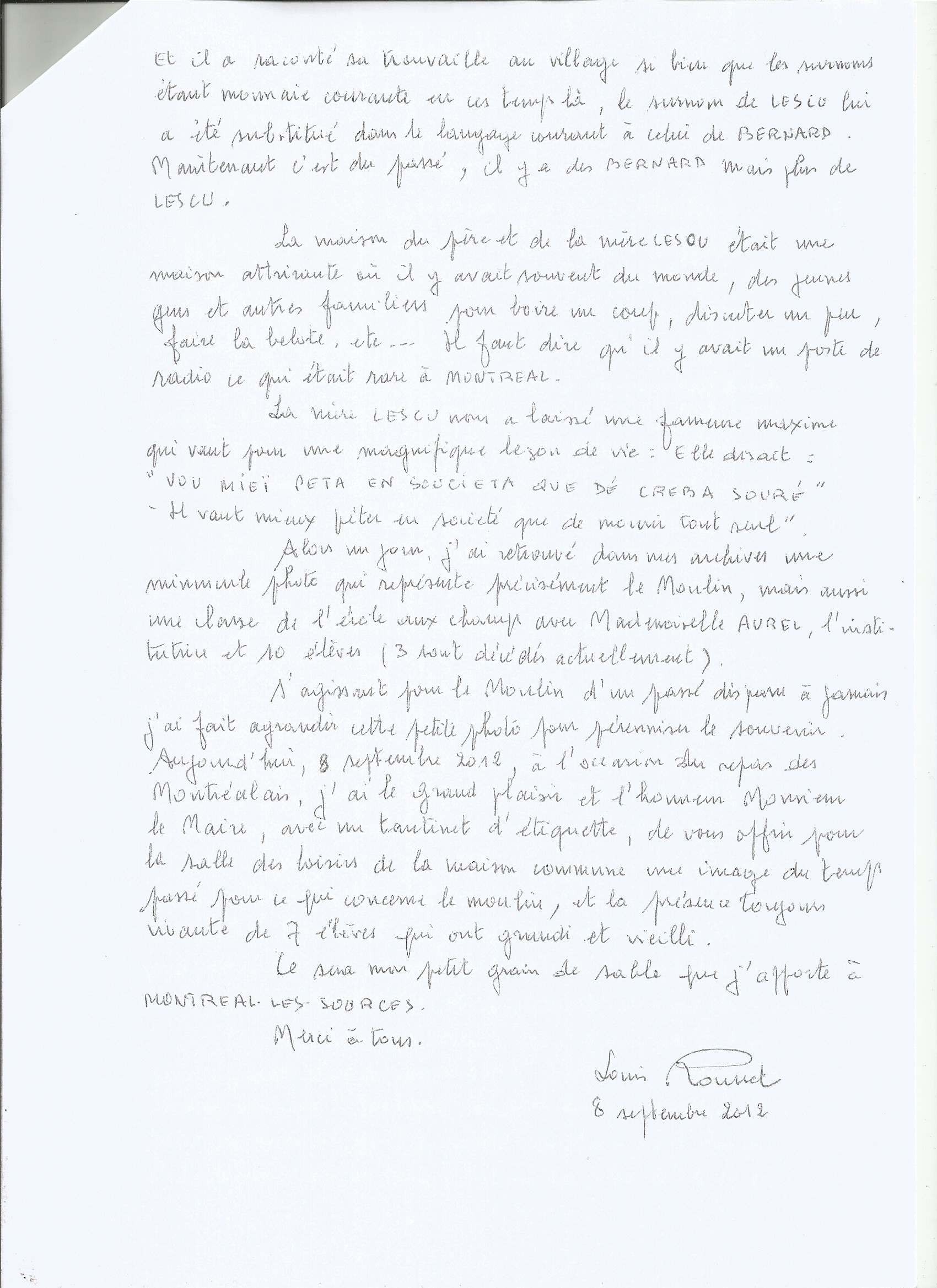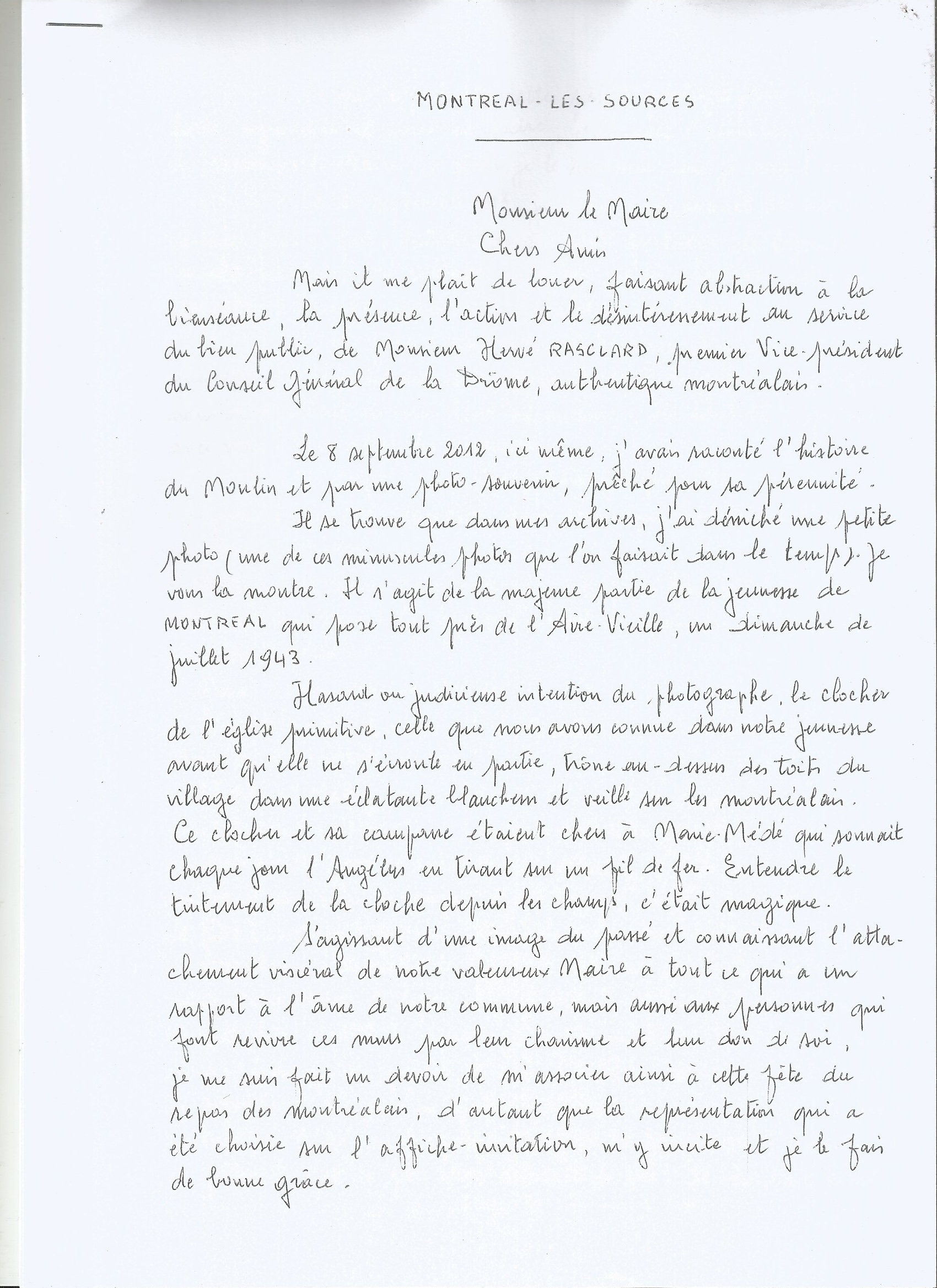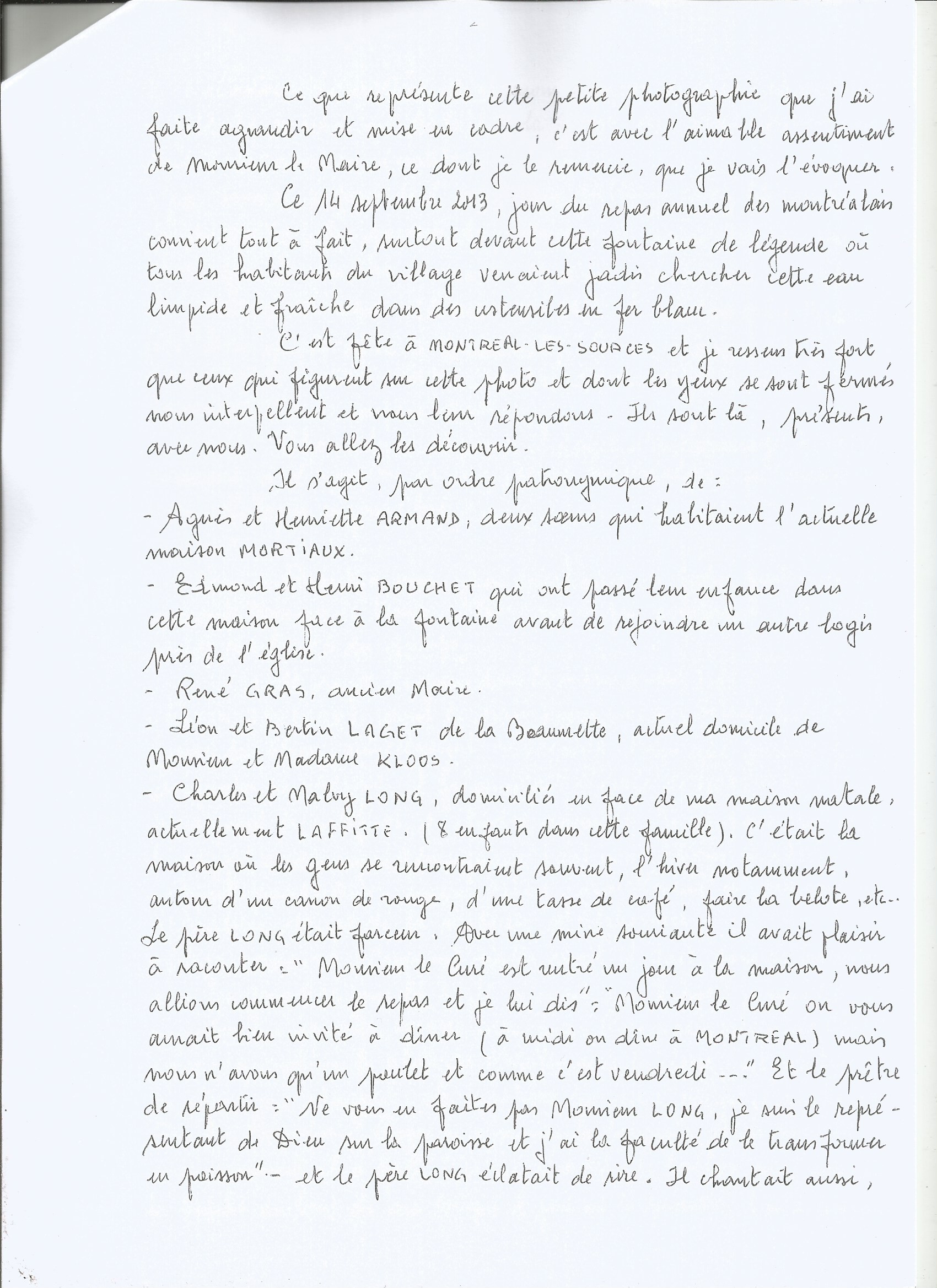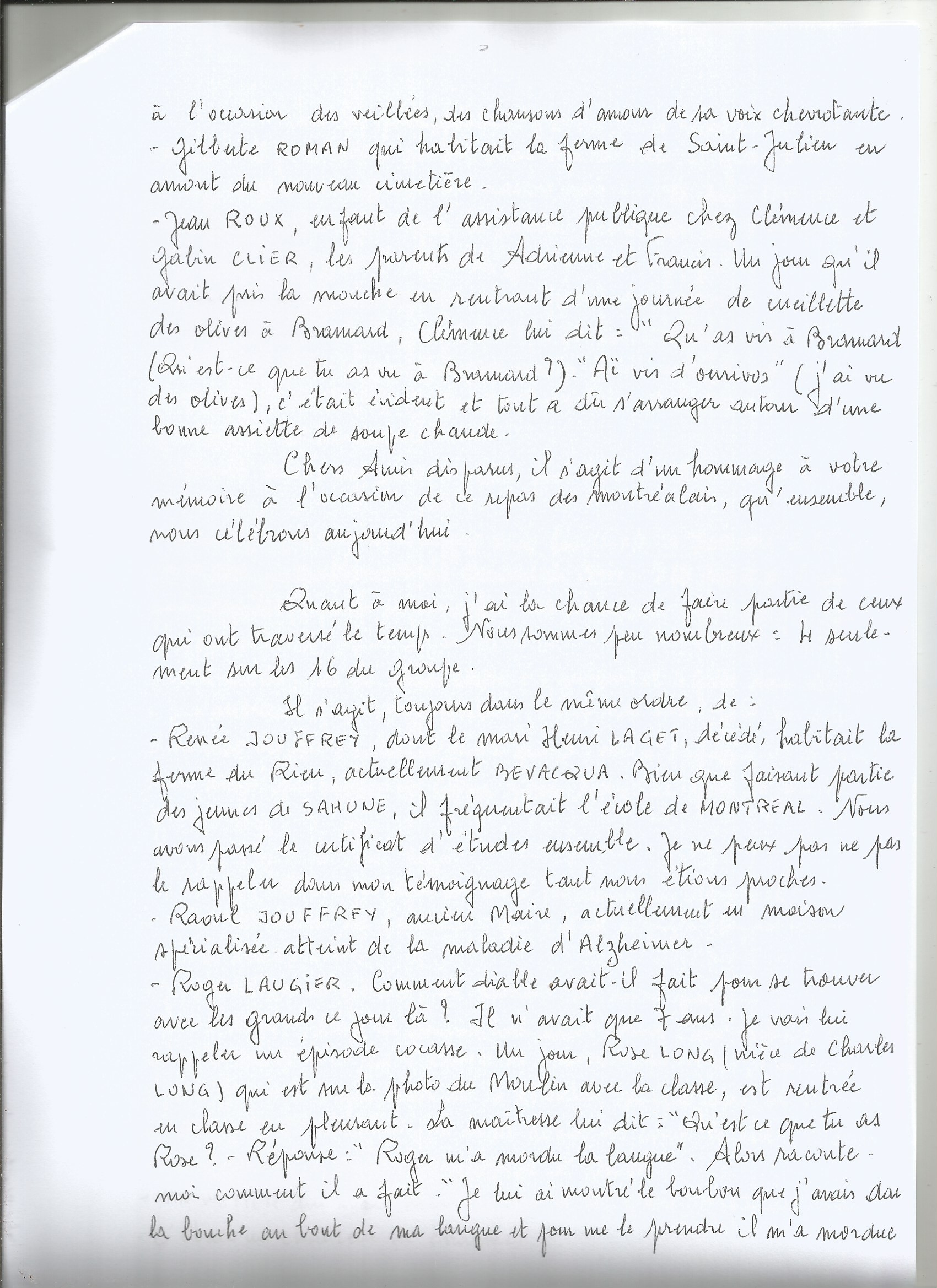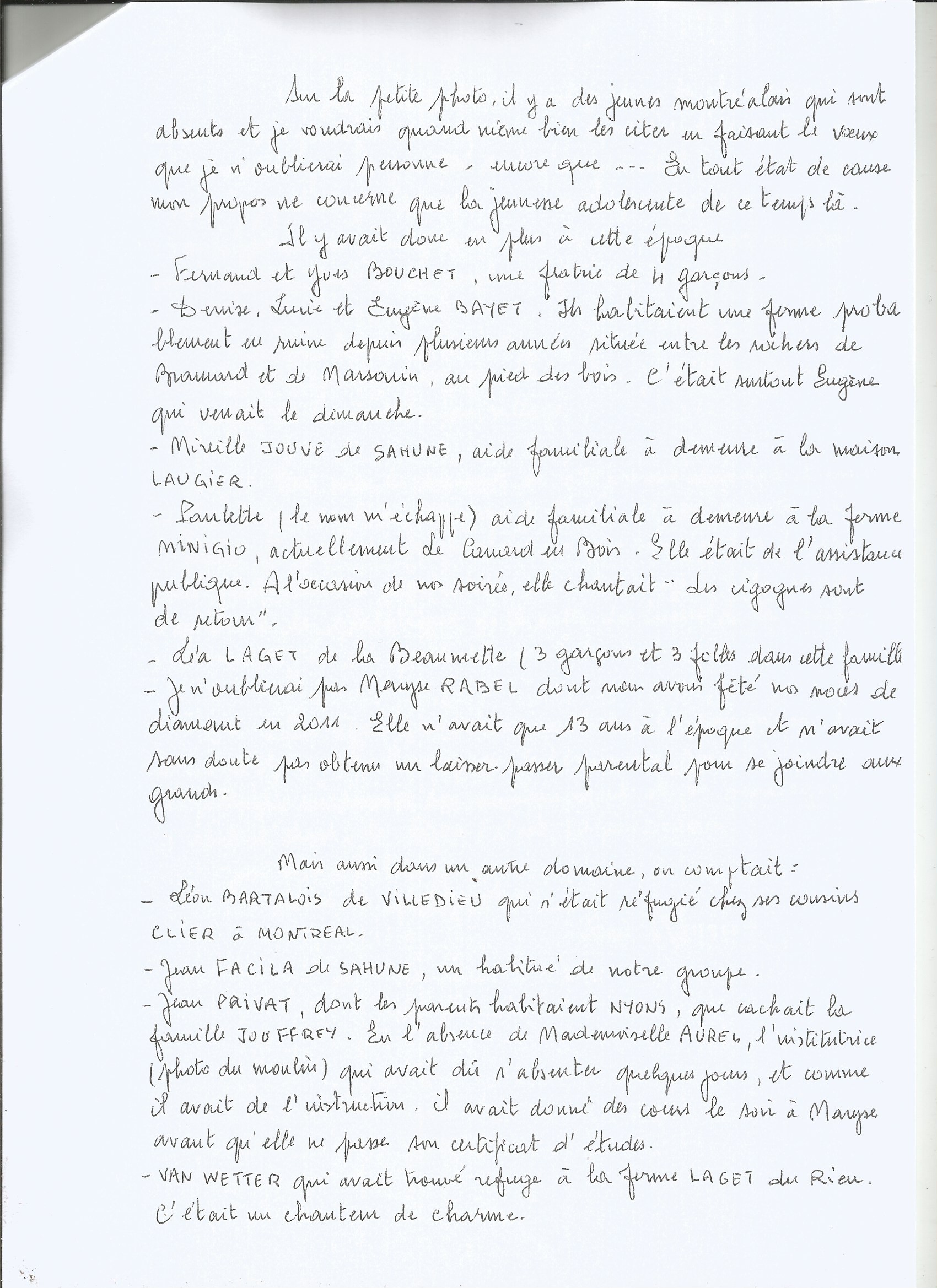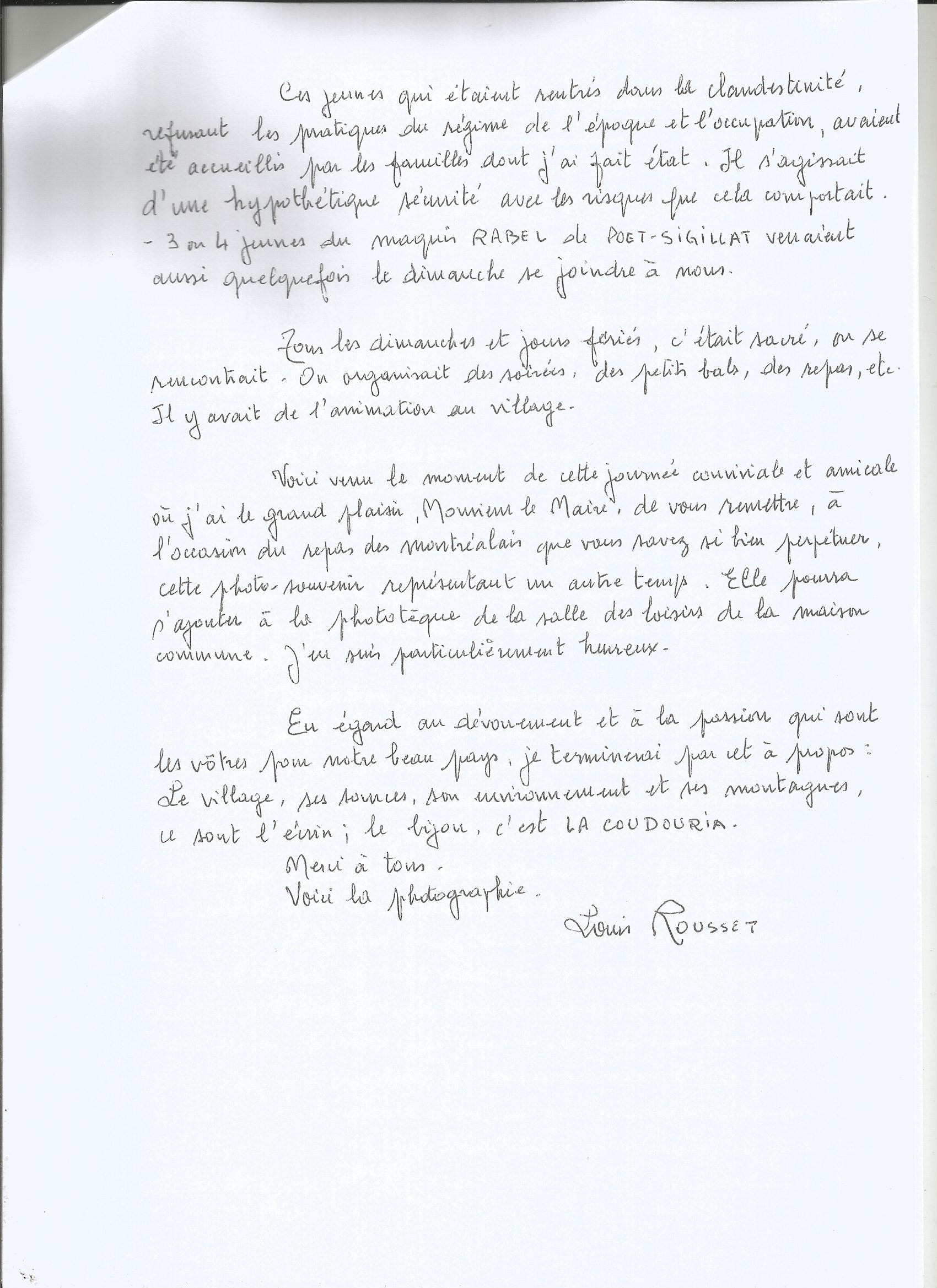Les Souvenirs de MAMYVETTE
Aussi sa stupeur fut grande, sa frayeur devrais-je dire lorsque à minuit elle entendit sous la fenêtre de sa chambre, une sérénade (on disait alors une réveillée) orchestrée par 5 ou 6 jeunes gens du village (entre autre celui qui devait ensuite être mon père) ils avaient même eu l’audace de mettre une échelle, pour arriver jusqu’aux volets de sa chambre.
Le lendemain elle se rendit chez le Maire pour lui raconter sa mésaventure. Le Maire Monsieur GRAS, le père de Valérie la rassura lui assurant que c’étaient des braves garçons, que c’était la façon à eux de lui souhaiter la bienvenue. Par la suite, tous devinrent de bons amis puisque en 1911 ma mère épousait mon père qui devint par la coutume du pays « Louis de la Dame ». En ce temps là l’institutrice était très respectée et elle était appelée « La Dame » ou « la Demoiselle » selon le cas.
Les jeunes gens continuèrent à chanter des « réveillées » en tout bien tout honneur.
Les Veillées au village
La vie au village se passait calmement. La bonne entente y régnait même le curé et l’institutrice de convictions différentes et opposées s’entendaient bien.
En ce temps là la télé n’existait pas on se réunissait le soir après souper à plusieurs familles pour trier les amandes ou les noix ce qu’on appelait « veiller».
Le père, une brique sur les genoux, un marteau à la main, une corbeille devant lui cassait noix ou amandes. (Il y avait de nombreux amandiers à Montréal). Tous les amis se mettaient autour de la table éclairée par la lampe à suspension à pétrole. On séparait le fruit de la coquille, celle-ci servait ensuite à alimenter le feu et on devisait gaîment, racontant les potins du village, on s’entraidait beaucoup entre voisins, on allait tantôt chez les uns tantôt chez les autres et l’hiver qui était assez long se passait sans problème.
On s’entraidait beaucoup disais-je. Lorsqu’un des habitants tuait le cochon tout le monde était invité et on faisait un bon repas avec le boudin et la fricassée.
On s’entraidait aussi dans les moments difficiles, lorsqu’il y avait un malade (le téléphone n’existait pas) un homme valide partait à pied par le Col de Bas Coulet pour aller chercher le Docteur Marchat qui habitait à Rémuzat et qui venait en voiture à cheval. En attendant qu’il arrive on allait chercher la Mère Laugier qui faisait office d’infirmière ou de sage femme avec les remèdes bien à elle. On allait chercher le docteur qu’en dernière extrémité.
La vogue
Elle avait lieu le premier dimanche de septembre. Deux ou trois jours avant les jeunes préparaient les guirlandes de buis. Elles servaient à entourer le bal, réunissant entre eux quatre poteaux fixés aux quatre coins de la place. Une estrade dressée dans un coin de la place pour l’unique musicien qui remplaçait à lui tout seul un orchestre, des grelots attachés aux chevilles, des cymbales attachées aux genoux et un violon. Le musicien ne connaissant pas les notes jouait de routine.
Le matin de très bonne heure les jeunes faisaient péter les « boites », ils avaient préparé de la poudre dans une boite de conserve et y mettaient le feu, ce qui faisait une grosse déflagration s’entendant à 3 ou 4 kilomètres à la ronde. Tout ceci se passait au fond de la côte pour une plus grande sécurité. C’était le signal du début de la fête.
Le matin de bonne heure Dési (Fréderic) et sa femme Augusta (sœur de Marthe Rabel), installaient la Carabasse, un stand où on trouvait des bonbons, des pralines, on faisait tourner une roue, pour gagner des verres de praline s et le stand de tir amusait les grands. Vers 3 heures l’orchestre s’installait et le bal ne débutait que pour se terminer à 1heure du matin, avec une petite interruption pour réunir tous les amis et les cousins à un autre bon repas. A une heure du matin une farandole réunissant tous les gens valides se déroulait à travers tout le village.
Dans l’après midi les hommes se réunissaient sur l’aire vieille à l’entrée du village pour se livrer à un jeu extrêmement cruel, on attachait un coq par les pattes à une pierre et le jeu consistait à lui lancer des cailloux jusqu’à ce que mort s’ensuive, avait gagné celui qui avait donné le coup de grâce. Je n’assistais jamais à ce jeu là que je trouvais trop cruel. (la danse m’attirait davantage).
Les danseurs s’en donnaient à cœur joie et on allait se désaltérer au café que la mère Mélina (la mère de Marthe Rabel) ouvrait uniquement ce jour là. Ce jour là était une journée mémorable pour le village on y pensait longtemps à l’avance. Après la grande farandole à 2 heures du matin dans toutes les rues du village les feux s’éteignaient jusqu’au 1er septembre de l’année suivante.
Le jeudi le marché de Nyons
Lorsque le mercredi le temps s’annonçait beau pour le lendemain, nos parents, toujours soucieux de nous faire plaisir, nous promettaient de nous emmener au marché de Nyons.
Quelle effervescence à la maison, nous en étions tout excités. Le jeudi matin de bonne heure papa attelait Coco à la voiture à quatre roues (quatre roues signe de richesse). Et nous partions pour un voyage de 2 heures jusqu’à Nyons.
Arrivés à Nyons on détachait Coco à la place du Foussat et on l’emmenait à l’écurie (chaque propriétaire de cheval avait une écurie à Nyons). Et en plus nous avions au dessus de l’écurie, une chambre. On avait eu soin d’emporter une botte de foin pour Coco qui avait besoin de reprendre des forces pour le chemin du retour. Nous partions ensuite au marché pour faire les achats pour la semaine.
Ce qui m’a marqué le plus c’est lorsque maman allait acheter pour le diner de midi ; de la charcuterie, des radis, du fromage. Nous allions (comme tous les gens) nous installer à une table sous les platanes sur la place du Champ de Mars. Que ces côtes de porc achetées chez le charcutier étaient bonnes, que ces radis étaient savoureux ! C’était une fête, nous n’avions pas l’occasion d’en manger souvent surtout en pique nique.
Après un dernier tour parmi les marchands forains nous reprenions le chemin du retour, tous étourdis de la journée bruyante que nous avions vécue. Arrivés à Sahune, nous les enfants restions bien installés dans la voiture, mais papa et maman et toutes les grandes personnes descendaient de voiture et montaient à pied en suivant le cheval, pour que la voiture ne soit pas trop lourde à trainer pour notre pauvre Coco, pour qu’il puisse tenir le coup jusqu’à Montréal, où l’attendait l’abreuvoir et une bonne ration d’avoine.
La lessive en Haute Provence
Deux fois par an, au printemps et à l’automne c’était la grande lessive. (Ce qui expliquait les grands trousseaux que chaque jeune fille devait apporter dans la corbeille de mariage ; 12 draps, 12 chemise autant de culottes, un beau service de table etc.). On s’y préparait quelques jours à l’avance, on vidait et on lavait le bassin communal et l’on mettait à tremper ce qu’on avait trié auparavant, les draps d’un côté, le petit linge de l’autre qu’on mettait dans un drap les quatre coins rassemblés et noués. Le lendemain matin, la Joséphine arrivait de bonne heure de la Casse (ferme située vers Bramard) elle s’installait devant un bon café pour se remettre du chemin qu’elle venait de parcourir (au moins 2 kilomètres depuis sa ferme).
Elle allait au lavoir pour toute la journée elle décrassait le linge à grands coups de battoir et le frottant énergiquement entre les mains. On avait soin de mettre devant elle une planche verticale pour éviter les éclaboussures d’eau et qu’elle ne se mouille pas. Et cela jusqu’au repas de midi où elle venait prendre place à la table familiale.
L’après midi se passait encore au bassin. Le soir on installait le linge dans la benne (grand cuveau métallique de 1,20 à 1,50 m de diamètre). On avait conservé pendant toute la saison les cendres de bois. (Il ne faut pas oublier qu’on faisait du feu au bois toute l’année, on n’avait pas d’autre moyen pour faire les repas). On mettait ces cendres de bois dans des grands sacs qu’on étalait au fond de la benne, on mettait sur le tour une poignée de sarments de vigne pour ne pas l’obturer et pour faciliter l’écoulement du lessif. On mettait ensuite les draps bien étalés, ensuite le petit linge. Près du cuveau on installait une chaudière où l’on faisait chauffer l’eau. On prenait l’eau bouillante avec une casserole et on arrosait très consciencieusement toute la surface du cuveau, le lessif sortait par le trou du cuveau, il était récupéré dans un récipient, on remettait à chauffer cette eau dans la chaudière et toute la journée on recommençait inlassablement (Arroser, réchauffer). Ce n’est que le lendemain que la Joséphine revenait se remettre au bassin pour toute la journée.
Les grands coups de battoir reprenaient mais le linge sortait impeccable de ses mains et pour une blancheur ‘encore plus blanche comme dirait maintenant OMO) on passait en terminant le linge au bleu. (On ne connaissait pas la Javel). On faisait dissoudre des boules de bleu dans une bassine et en dernier lieu on y plongeait le linge qui sortait d’une blancheur éclatante. On allait ensuite mettre une corde au jardin entre deux arbres et on étendait le linge au grand soleil à l’abri de toute poussière.
La Corvée de la Lessive, c’était vraiment une CORVEE.
More